Faites votre choix! J’ai longtemps hésité avant de faire le mien! J’ai commencé à publier avant que la féminisation des métiers soit acceptée dans le dictionnaire et, par soucis d’une bonne orthographe, j’ai commencé à me désigner comme un auteur, ou une romancière, ce qui ne laissait pas de doute sur mon activité. Puis, influencée par le public qui me qualifiait d’auteure, j’ai adopté ce terme, à contrecœur.

Jusqu’à ce que je prenne une décision et décide d’employer fièrement le mot autrice, même si beaucoup trouvent ça « moche ». Pour ma part, j’aime que ce mot sonne comme ses copains: actrice, institutrice, directrice, ambassadrice. Qu’il fasse entendre une syllabe finale volontaire, contrairement à auteure dont la terminaison timide s’efface rapidement à l’oral.
Bref, pour étayer mon propos, je vous propose un saut dans le temps en compagnie d’un nom malmené par l’histoire.
Fluctuations historiques
Le mot autrice n’est pas une invention contemporaine, mais une forme ancienne qui plonge ses racines dans l’histoire de la langue française et, au-delà, dans la latinité. Son emploi, bien attesté durant plusieurs siècles, témoigne d’une époque où la féminisation des noms de métiers et de fonctions était une pratique naturelle et courante.
Pendant plusieurs siècles, la féminisation des noms de métiers a progressivement disparu, non pas par un manque de pertinence linguistique, mais sous l’influence de transformations sociales et politiques. L’histoire de cette disparition est étroitement liée à la place accordée aux femmes dans la société et aux normes imposées par les institutions.
Usage courant et reconnu

Le terme autrice vient directement du latin classique. Le mot masculin auctor, signifie « celui qui augmente, crée ou fait autorité », a pour pendant féminin auctrix, utilisé pour désigner une femme exerçant les mêmes fonctions. Cette parité linguistique est courante dans la langue latine, où de nombreux noms possèdent des formes masculines et féminines distinctes, selon le genre du référent.

En latin médiéval, ces formes ont continué d’être utilisées et adaptées, notamment dans les chartes et documents ecclésiastiques. Ainsi, auctrix a évolué dans les langues romanes, donnant naissance à autrice en français, au même titre que actrice pour actrix ou impératrice pour imperatrix.
Durant le Moyen Âge, le mot autrice fait partie intégrante du vocabulaire pour désigner une femme ayant une autorité créatrice, notamment dans le domaine littéraire ou religieux. À cette époque, les femmes lettrées et écrivaines, bien que peu nombreuses en raison des contraintes sociales, peuvent être reconnues comme telles. Les documents de l’époque utilisent d’ailleurs des féminins pour qualifier leur rôle, comme autrice, compositrice ou traductrice.
De Christine de Pizan (Le Livre de la cité des dames, 1405), première femme à vivre de sa plume, à Marie de France (Les Lais de Marie de France, XIIᵉ siècle), en passant par Héloïse (Lettres à Abélard, XIIᵉ siècle) et Hildegarde de Bingen (Scivias, XIIᵉ siècle), jusqu’à Marguerite de Navarre (L’Heptaméron, 1558), ces autrices ont marqué l’histoire littéraire et revendiqué leur place dans un monde qui leur en offrait peu.

Apogée des formes féminisées
Avec la Renaissance (XVe-XVIe siècles), la langue française permet une flexibilité dans la désignation des professions exercées par des femmes. Le mot autrice existe aux côtés d’autres formes féminisées comme autoresse, poétesse, philosophesse, ou encore doctoresse. Ces termes sont utilisés sans controverse notable pour désigner des femmes exerçant ces fonctions.
Des écrivains de renom, tels que François Rabelais et Michel de Montaigne, utilisent couramment ces termes dans leurs écrits. Rabelais, par exemple, emploie autrice dans Pantagruel pour la Sibylle de Panzoust, présentée comme l’autrice supposée d’un recueil de prophéties. Bien qu’il soit burlesque, l’utilisation du mot autrice montre que cette forme est encore en usage au XVIᵉ siècle pour désigner une femme ayant une activité littéraire. Montaigne utilise le mot autrice dans ses Essais (1580-1595). Il emploie cette forme féminine dans le cadre d’une réflexion sur les femmes, la création et l’autorité.

Ce naturalisme dans la langue reflète une absence de codification stricte : les écrivains et lettrés adaptent spontanément les mots aux réalités qu’ils décrivent, sans ressentir le besoin de maintenir un masculin générique pour désigner les femmes.
Standardisation et idéologie
C’est au XVIIe siècle que la situation commence à changer, avec l’émergence d’un souci croissant de régularisation et de standardisation de la langue française. Sous l’impulsion de l’Académie française, fondée en 1635 par Richelieu, le français se voit codifié selon des règles strictes. Cette institution, dominée par des hommes et soucieuse de promouvoir un idéal linguistique supposément universel, privilégie le masculin générique pour des raisons à la fois idéologiques et pratiques.

Les formes féminines, jugées encombrantes ou inutiles, sont peu à peu écartées des dictionnaires et des textes officiels. Dans le Dictionnaire de l’Académie française de 1694, première édition de cet ouvrage de référence, le mot autrice est absent, alors qu’il figure encore dans les usages littéraires.
Effacement progressif paradoxal
L’émergence des Lumières et le développement des idéaux universalistes renforcent le masculin générique, contrairement à ce qu’on aurait pu penser. Si les femmes continuent à écrire, leur reconnaissance se fait au prix de leur invisibilisation linguistique. À cette époque, on préfère désigner une autrice par des périphrases comme une femme auteur ou une dame qui écrit, plutôt que d’utiliser un terme féminin spécifique. Cette évolution reflète un paradoxe : tandis que les Lumières prônent une égalité théorique entre les individus, elles excluent les femmes de la sphère publique, et la langue s’en fait le relais.
Effacement de la féminisation

La Révolution française (1789) a pourtant amorcé une certaine reconnaissance des droits des femmes. Des figures comme Olympe de Gouges, autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791), revendiquent une égalité pleine et entière, y compris dans la langue. Ces aspirations sont cependant rapidement étouffées sous l’Empire.
L’instauration du Code civil de Napoléon, en 1804, marque une véritable régression pour les droits des femmes. Ce texte institutionnalise leur subordination légale aux hommes, les cantonne au rôle de mères et d’épouses. Cette idéologie patriarcale influence la perception des femmes dans les professions intellectuelles. Napoléon lui-même méprise les femmes écrivaines, affirmant que leur rôle est de « tenir leur maison et élever leurs enfants », ce qui contribue à marginaliser leur présence dans les sphères publiques et littéraires.
En 1805, un décret impérial ordonne l’uniformisation de la terminologie administrative et juridique, imposant le masculin générique dans les textes officiels. Ainsi, le terme auteur est consacré au masculin pour désigner toute personne exerçant cette fonction, hommes ou femmes.
Le XIXe siècle, marqué par la montée des idéaux bourgeois et patriarcaux, a encore renforcé cette disparition. Les femmes écrivaines, bien que nombreuses, se voient souvent contraintes d’écrire sous pseudonyme masculin pour être publiées ou prises au sérieux. George Sand, (Amantine Aurore Lucile Dupin, 1804-1876) l’une des grandes figures littéraires de l’époque, en est un exemple emblématique. au même titre que les sœurs Brontë – Charlotte (Currer Bell), Emily (Ellis Bell), et Anne (Acton Bell) – ou encore Delphine de Girardin (Vicomte de Launay, 1804-1855), qui écrivent sous des pseudonymes masculins pour contourner les préjugés de leur époque. Elles marquent pourtant durablement la littérature avec des œuvres comme Indiana, Jane Eyre, et Lettres parisiennes.

Lent retour des féminins
La situation évolue timidement au XXe siècle. Les premières revendications pour la féminisation des noms de métiers réapparaissent dans les années 1920-1930, parallèlement à l’essor des mouvements féministes. Toutefois, les institutions, notamment l’Académie française, restent fermement opposées à ces changements. Dans les années 1930, certaines écrivaines comme Colette osent revendiquer leur identité féminine dans leur œuvre, mais la langue officielle reste figée.
Il faut attendre les années 1970, dans le contexte des luttes féministes, pour que la question de la féminisation de la langue refasse surface. C’est à ce moment-là que des linguistes, des écrivaines et des militantes commencent à réclamer un retour des formes féminines comme autrice ou la création de nouveaux termes tels qu’auteure.
La popularité du mot auteure s’accroît à partir des années 2000 grâce à des voix influentes, notamment celle de la journaliste Anne Sinclair. Dans un article publié dans Le Monde en janvier 2001, Sinclair déclarait : « Il est temps que la langue française reconnaisse le sexe des auteurs. »
Ce débat s’amplifie dans les médias, soutenu par des études linguistiques et des recommandations officielles. En 2002, la Commission générale de terminologie et de néologie encourage l’utilisation du féminin pour les noms de métiers, y compris auteure. En 2006, le Conseil supérieur de la langue française appuie cette proposition, ouvrant la voie à une reconnaissance institutionnelle.
Reconnaissance officielle
En 2012, l’Académie française, longtemps réticente à toute modification de ses règles, adopte une position favorable à l’usage de formes féminines. Cette reconnaissance s’accompagne de la création d’un groupe de travail pour examiner l’intégration de ces féminins dans la norme écrite et orale.
Enfin, en février 2019 (seulement!!!) , l’Académie française publie un rapport marquant un tournant décisif. Ce document entérine la féminisation des noms de métier, de fonction, et de statut. Cependant, la coexistence des deux formes – auteure et autrice – reflète des sensibilités différentes : auteure s’inscrit dans une tradition récente, tandis que autrice revendique une filiation historique et littéraire.
Pour ma part, j’ai tranché! Et vous?

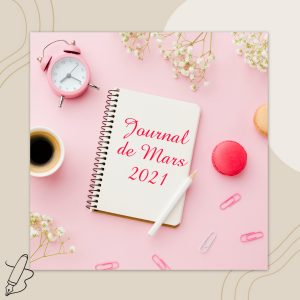


Quel excellent article très instructif! Merci!
Merci, avec plaisir. J’adore me documenter sur les sujets qui m’animent. Cela nourrit aussi mes romans!
Je ne savais pas tout cela, je vais utiliser ces mots de façon plus juste maintenant. Merci.
On peut utiliser le terme qui nous convient, grâce à un grand flou artistique!
Je suis de celles qui trouvent autrice pas très beau, je préfère auteure.
Chacun ses goûts, ce qu’il y a de bien avec le flou actuel, c’est qu’on peut dire comme on veut!
Quel explosé! Parfois, ça me fait penser un peu à la Servante écarlate, cette façon d’effacer les femmes!
En effet, tout commence par des décisions du pouvoir… et la masse suit. Tellement d’actualité dans tellement de pays à l’heure actuelle.
Perso j’ai adopté autrice, mais j’accepte sans problème les autres appellations ☺️
Tout à fait d’accord.
J’ai fini par adopter “autrice”.😉
idem, après maintes hésitations.
Je préfère « auteur ». Je suis de la vieille école avec mes dicos de correctrice ! Et je ne m’en sens pas dénigrée dans ma féminité pour autant 😊
Eh oui, comme les décisions prises par nos linguistes ne le sont pas vraiment, on fait comme on veut. J’avoue qu’avant de faire des recherches pour cet article, je m’en fichais, mais depuis, je tiens à cette féminisation.
Auteur(e)… ou autoresse. Point barre pour moi. Mais je suis romancière…
On peut être dramaturge, biographe, monographiste, poètesse, nouvelliste, pamplétaires, fabulistes, etc.
Selon ce que l’on écrit.
C’est ça, jusqu’à présent, je favorisais aussi le « romancière ».
Je te remercie pour l’éclairage. J’ai toujours peur de froisser les ecrivaines, alors j’emploie le terme « auteure ». Mais je me suis en effet déjà fait la remarque quant à ce « e » timide et vite oublié. Donc j’opterai désormais pour une « autrice » assumée.
Ce qui est bien, à l’heure actuelle, c’est qu’on peut faire comme on veut.
Je hais le mot « autrice ». Un auteur, unE auteurE, point. J’assume !
Mais tout à fait, le flou des linguistes nous permet justement de choisir!
Bonjour, je suis auteure, mais aussi poète et slameuse 🙃. L’ essentiel en tant que femme, est de se sentir en osmose avec ce que l’on est😃🌻📚.
eh oui, exactement! Vive les artistes!